Viking - Laval - Rüffert- Luxembourg
Libertés économiques versus droits sociaux fondamentaux – où se situe l’équilibre ?
|
en collaboration avec Notre Europe |
|
Comment trouver le bon équilibre entre l’application des règles de libre circulation de l’Union européenne - en particulier, le droit de travailler et de fournir des services dans un autre État Membre – et le maintien de différents systèmes sociaux nationaux ?
Plus précisément, comment ces libertés affecteront-elles les droits syndicaux comme le droit de mener des actions collectives et des négociations collectives ?
Ces questions font l’objet d’un vif débat, suite à trois jugements rendus récemment par la Cour de justice européenne.
L’ETUI et Notre Europe ont dès lors décidé de lancer ce forum sur lequel les utilisateurs trouveront des informations sur les différentes affaires et l’analyse de divers experts.
Réaction de l’Europe aux jugements
1) Évaluation critique
2) Articles de la littérature académique sur les jugements
3) Réaction des partenaires sociaux aux jugements
4) Articles – Presse – etc.
5) Vos commentaires/articles/points de vue
Les affaires
Viking C-438/05
Laval C-341/05
Rüffert C-346/06
COM v LUX C-319/06
- Les faits
La compagnie de navigation maritime Viking assure le transport par ferries entre la Finlande et l’Estonie sous le pavillon finnois. La direction de la compagnie a décidé de re-pavoiser ses ferries en utilisant le pavillon estonien. Il a également été décidé d’employer de la main-d’œuvre estonienne afin de profiter des salaires plus bas en Estonie. En réponse, la Finnish Seamen’s Union (FSU) a averti la compagnie Viking qu’elle pourrait mener une action collective pour arrêter le processus de re-pavoisement. Pour ne pas prendre le risque d’être court-circuitée, elle a également prié la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), dans le cadre de sa campagne “pavillon de complaisance”, de demander à ses membres de pas entamer de négociations avec Viking à moins qu’ils ne soient basés en Finlande. Conformément à cette campagne, les membres de l’ITF ont convenu que seuls les syndicats établis dans l’État de propriété effective avaient le droit de conclure des conventions collectives couvrant le navire concerné.
- Le jugement
La CJE a reconnu le droit à l’action collective, y compris le droit à la grève comme un droit fondamental qui fait partie intégrante des principes généraux du droit communautaire. Toutefois, ce droit peut être restreint, comme confirmé par l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui dispose qu’il doit être protégé conformément au droit communautaire et aux lois et pratiques nationales. De plus, l’exercice de ce droit peut être soumis à certaines restrictions.
Dans les affaires Laval et Viking, la CJE stipule que le droit national du travail tombe sous le coup de la législation communautaire sur la libre circulation. Cela signifie qu’aucun traitement spécial n’est appliqué dans la sphère du droit du travail. Les juges vont même plus loin lorsqu’ils considèrent que les libertés peuvent être invoquées contre les syndicats (c’est ce qu’on appelle l’effet direct horizontal). Autrement dit, les employeurs peuvent désormais poursuivre en justice les syndicats pour obtenir un jugement sur la légalité d’une action collective.
La CJE considère le droit des syndicats de mener une action collective comme une restriction de la liberté de fournir des services ou de la liberté d’établissement. L’action collective doit pouvoir être justifiée. Elle doit chercher à atteindre un but légitime, répondre à des raisons impérieuses d’intérêt général, correspondre aux objectifs recherchés et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Ces conditions sont souvent appelées le test de proportionnalité, qui est désormais introduit par la cour concernant les droits des syndicats.
La protection des travailleurs est un intérêt légitime, qui justifie en principe une restriction d’une des libertés fondamentales garanties par le Traité. Il revient en principe aux juridictions nationales de vérifier si les objectifs poursuivis au moyen d’une action collective visent la protection des travailleurs. Toutefois, la Cour impose des orientations très strictes aux juridictions nationales concernant la façon dont elles doivent juger de telles affaires. Elles doivent répondre à la question de savoir si les emplois et conditions de travail sont réellement compromis ou sérieusement menacés par le comportement de l’entreprise.
Lire le jugement
Lire l'avis de l'Avocat général POIARES MADURO
haut de la page
- Les faits
La compagnie lettonne Laval a remporté l’appel d’offres pour des travaux de construction à une école de la ville de Vaxholm. Elle a détaché ses ouvriers de Lettonie en Suède pour exécuter le contrat. Comme c’est de pratique standard dans le système social suédois, les syndicats suédois ont entamé des négociations avec Laval afin de signer une convention collective sur les salaires et autres conditions de travail, qui sont toujours fixés par voie de négociation au cas par cas. Comme Laval ne voulait pas payer les salaires demandés, elle a signé une convention collective en Lettonie. Suite à l’échec des négociations suédoises, les syndicats suédois ont mené des actions en bloquant le site de construction. Il s’en est suivi des actions de solidarité des syndicats des électriciens.
- Le jugement
Concernant le droit de grève comme droit fondamental et la portée des libertés, le jugement de Laval a développé la position antérieurement établie par le jugement Viking. La CJE applique de nouveau le test de proportionnalité et affirme que l’action collective pour la protection des travailleurs du pays d’accueil contre du dumping social peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général, qui justifie en principe une restriction d’une des libertés fondamentales. L’action de blocage menée par un syndicat s’inscrit dans l’objectif de protéger les travailleurs. Mais en l’espèce, l’action ne pouvait être justifiée en raison d’une mise en œuvre incorrecte de la directive concernant le détachement des travailleurs.
La majeure partie du jugement concerne l’interprétation de cette directive. La CJE estime que les négociations sur le lieu de travail, sur une base au cas par cas, lorsque les taux de rémunération minimaux ne sont pas déterminés conformément à un des moyens fournis par la directive concernant le détachement des travailleurs, ne sont pas permises dans le cadre de la Directive. La Cour a remis en question la flexibilité du système suédois de négociations collectives, soulignant le manque de sécurité pour les entreprises, incapables d’établir à l’avance les conditions qu’elles devraient garantir à leurs travailleurs détachés.
L’objectif de la directive concernant le détachement des travailleurs consiste à fixer des règles impératives pour une protection minimale à respecter dans le pays d’accueil par les employeurs qui détachent des travailleurs pour effectuer du travail temporaire sur le territoire d’un État membre où les services sont fournis. La CJE estime que la directive limite le niveau de protection garanti aux travailleurs détachés. Ni l’État membre d’accueil ni les partenaires sociaux ne peuvent demander des conditions plus favorables, allant au-delà des règles impératives prévues par la directive pour une protection minimale. Il y est souvent fait référence pour souligner la mutation d’une directive minimale en une directive maximale.
Lire le jugement
Lire l'avis de l'Avocat général MENGOZZI
haut de la page
- Les faits
Une société allemande a remporté, avec le Land de Basse Saxe, l’appel d’offres relatif à la construction d’une prison. La législation de ce Land en matière de marchés publics stipule que “les contrats pour les services de construction ne doivent être attribués qu’aux entreprises qui, lorsqu’elles participent à un appel d’offres, s’engagent par écrit à payer à leurs travailleurs, dans le cadre de la réalisation de ces services, au moins la rémunération prévue par la convention collective de travail de l’endroit où ces services sont réalisés … ”. La société allemande a sous-traité le travail à une entreprise polonaise et il s’est avéré que les 53 travailleurs polonais gagnaient en fait seulement 46,57 % du salaire perçu par leurs collègues allemands sur le site. Par conséquent, le Land de Basse Saxe a appliqué les sanctions contractuelles, a annulé le contrat et a infligé des amendes à la société.
- Le jugement
A nouveau, la CJE a rendu un jugement en vertu de la directive sur le détachement de travailleurs. Selon elle, la situation en Basse Saxe ne remplissait pas les critères pour fixer la rémunération comme le prévoit la directive, étant donné que la législation même ne fixe aucun taux de rémunération minimum et que la convention collective visée n’a pas été déclarée universellement applicable. La Cour dispose à nouveau que la directive sur le détachement de travailleurs précise le niveau maximum de protection pour les travailleurs détachés et que dans une convention collective, comme en l’espèce, un niveau supérieur de protection ne peut être fixé.
La Cour souligne une nouvelle fois la nécessité de justifier la restriction de la liberté de fournir des services. La CJE ne voit aucun motif de protéger les travailleurs dans ce cas particulier, étant donné que la législation s’applique uniquement au secteur public et non au secteur privé. La CJE a également rejeté les arguments suivants : la durabilité financière des systèmes de sécurité sociale ou la sauvegarde de la liberté de négociation collective et de la liberté d’association.
Lire le jugement
Lire l'avis de l'Avocat général BOT
haut de la page
- Les faits
En juillet 2006, la Commission européenne a intenté une action contre le Luxembourg devant la CJE dans le cadre de la procédure d’infraction.
La Commission européenne estime que la législation du travail au Luxembourg n’est pas conforme à la directive sur le détachement de travailleurs.
Selon elle, le Luxembourg interprète trop largement le concept de 'dispositions d’ordre public' lorsqu’il place toutes ses dispositions contraignantes du droit du travail sous ce concept. Il en résulte que les prestataires de services étrangers sont tenus de respecter l’ensemble du droit du travail luxembourgeois.
Ce premier motif de plainte concerne plus particulièrement les aspects suivants :
(1) l’obligation pour les prestataires de services étrangers de n’employer au Luxembourg que des travailleurs détachés qui ont conclu un contrat de travail écrit ou préparé un document similaire ;
(2) l’adaptation automatique des salaires au coût de la vie ;
(3) les règles régissant l’emploi à temps partiel et à durée déterminée ;
(4) le respect des conventions collectives.
Lire le jugement
Lire l'avis de l'Avocat général Trstenjak
haut de la page
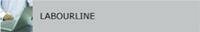

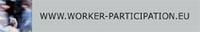

-
Flash sur ...
Memorandum CEE à Bruxelles, le 8 septembre
Viking - Laval - Rüffert- Luxembourg : Libertés économiques versus droits sociaux fondamentaux – où se situe l’équilibre?


